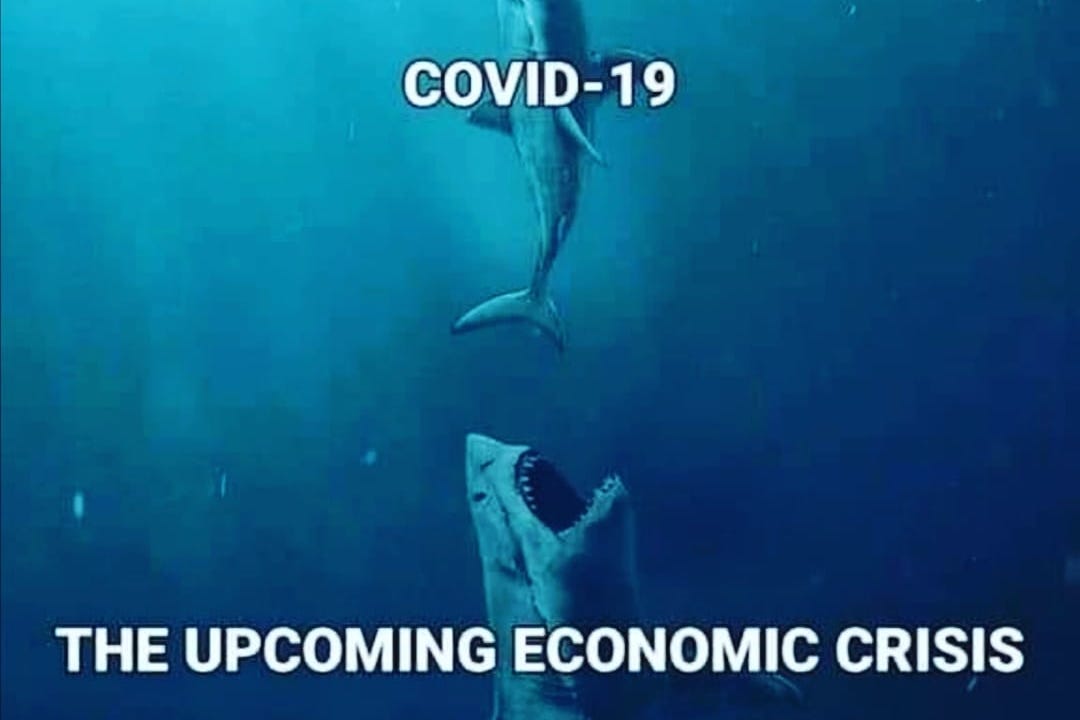Déjà le 31 janvier, Anne Chevalier réfléchissait à traiter le changement climatique comme le coronavirus, même si à l’époque cela nous semblait lointain et abstrait. Depuis, de nombreuses réflexions émergent sur l’ “après”, avec un souhait affiché par beaucoup de ne pas recommencer “comme avant”, voire d’opérer un « Corona-Reset » avec un premier objectif de réinventer nos démocraties. Mais comme Matthieu Peltier, je crains que les clivages reviennent et que les intérêts directs priment sur la volonté de changement.
Si beaucoup souhaitent qu’on “tire des leçons”, je m’interroge dès lors sur ce qu’il y a de semblable ou de foncièrement différent entre la situation actuelle et le monde à venir, celui de l’après pic-pétrolier et du changement climatique. Je vous partage ci-dessous des premières réflexions (désolé, c’est un peu long… comme le confinement 😀).
Similitudes
Le retour aux valeurs
On l’entend beaucoup, on le lit énormément : reprendre goût à l’essentiel, se soucier de ses proches, “quand la santé va… tout va…”. Pas mal de préoccupations, de frénésie, d’envies et d’achats inutiles semblent aujourd’hui bien futiles. Ce focus-là, il serait important à garder dans le futur.
Le retour aux travaux manuels
En période particulière, certains métiers semblent plus importants que d’autres, car tout être humain a d’abord et avant tout besoin de se nourrir, se loger et se vêtir (si, si, dans cet ordre-là !). La société (re)découvre que le marchand de légumes a un rôle plus critique que le marchand de gadgets, que les infirmiers et médecins ont un impact plus direct sur notre vie que les traders en bourse, que les éboueurs qui collectent les déchets sont au moins aussi importants que nombre de services administratifs.
Le premier point sur ces métiers qui perdurent dans la crise, et donc certains sont mis à l’honneur (pas tous, car nul n’a proposé d’applaudir les agriculteurs, les caissiers des magasins, les éboueurs…), c’est que ce ne sont pas forcément les métiers les mieux rémunérés. Sans tomber dans le poujadisme qui clame que certains salaires sont inversement proportionnel à leur utilité sociale, les gros salaires (PDGs de multinationale, joueurs de foot et autres acteur de sport-spectacle…) ne semblent pas être ceux dont on a le plus besoin en situation “critique”…

On a surtout (pas exclusivement) besoin de bras et de jambes pour rendre des services “physiques”. Dans un monde en résilience énergétique (que ce soit volontaire pour préserver le climat ou par diminution de la ressource) on aura plus besoin de plombiers, de réparateurs ou de travailleurs aux champs que de développeurs IT, d’intermédiaires financiers ou de cadres supérieurs.
Sans prétendre à une quelconque vérité, il me semble qu’il y a quelque chose d’intéressant dans l’idée bouthanaise (dont le projet global est en difficulté depuis quelques années) de proposer à chacun de combiner un travail intellectuel et un travail manuel.
De l’enseignement
Si on évite de tomber dans les polémiques stériles autour des vacances lorsque certains (économistes) ne voient dans l’école qu’une garderie pour permettre aux parents d’aller travailler, nombreux sont ceux qui se rendent compte de la valeur d’un bon système éducatif. Cela va d’études de qualité à des enseignant·es qui se coupent en quatre pour continuer à soutenir leurs étudiants et élèves, de la variété des savoirs auxquels il faut suppléer en tant que parents à la difficulté de gérer des enfants 24h/24 (la ligne de burn-out parental est d’ailleurs quelque peu débordée, me confiait une amie bénévole).
De l’économie réelle et du rôle des banques
Vendredi 3 avril, la Banque Centrale Européenne a demandé aux banques européennes de suspendre la distribution de tout dividende aux actionnaires (au moins jusqu’en octobre) pour “soutenir l’économie dans un environnement d’incertitude accrue”. Qui respecte cette recommandation sera sans doute relativement révélateur de leur esprit de solidarité, mais je trouve déjà intéressant que la BCE ait osé émettre cette idée. Il sera sans doute nécessaire d’aller plus loin dans des temps futurs, avec un focus sur l’économie réelle, celle qui fournit des emplois locaux et de quoi subsister (se loger, se vêtir, se nourrir…) et un détournement de la spéculation et autres montages purement financiers. Je trouve plus inquiétant d’ailleurs que d’aucuns se ruent sur les actions dont la cotation a baissé, ou que d’autres recommandent d’en profiter pour re-négocier son contrat de fourniture électrique (la valeur de toutes les énergies ayant chuté).
De l’économie et de la pollution
Car d’économie, nous continuerons d’en avoir tous besoin pour vivre dans le monde de demain. Mais peut-être plus de la même. Et si tout le monde a eu l’occasion de visualiser le lien très clair entre économie et niveau de pollution, tous les spécialistes craignent que le résultat final du coronavirus soit pire pour l’environnement car, tout comme nous acceptons certaines entorses à nos règles démocratiques pour lutter contre le virus, “on” risque de proposer d’autres entorses aux règles de production pour relancer l’économie “coûte que coûte” (pour l’environnement).
De la notion de vacances
Avec le confinement en pleine vacances de Pâques, chacun doit ré-inventer cette période l’année portée aux nues par le modèle capitaliste. Et si certains y voient un drame (ainsi le Soir titre “Les vacances de Pâques sont perdues”) de nombreu·ses citoyen·nes tentent plutôt de réenchanter leur quotidien. Cela est évidemment plus facile quand on habite une maison avec jardin et campagne alentours qu’un appartement sans terrasse. Mais cette remise en cause d’un “moment clé” touche à un de nos fondamentaux… et donc à nos valeurs. Et quand on sait que le tourisme de masse, avec notamment l’aviation low-cost (mais aussi de nombreux autres aspects), est responsable d’une part non négligeable des problèmes climatiques et environnementaux, voici peut-être une occasion de réfléchir la transition plus en profondeur.
Différences
Temps long

La crise du coronavirus a démarré en Chine début décembre, il y a 4 mois, et devrait être maîtrisée d’ici la fin de l’année (la fin du confinement ne marquera pas la fin de la crise). Ce sera donc une crise d’une bonne année. dès lors, les images comme celles ci-contre me semblent trompeuses.Si
Les problèmes environnementaux et le changement climatique en particulier sont connus depuis longtemps. La récente interview de Kroll dans la libraire francophone (à partie de 21’15’’) lui a permis d’exposer clairement son propos: cela fait plus de 30 ans qu’il dessine sur ce sujet, sans constater de changement majeur d’attitude !

Hors, les signes de changement qui deviennent clair aujourd’hui sont dus… aux émissions de la génération précédente dans les années 80. Et les efforts que nous tentons/pourrions/devrions réaliser aujourd’hui bénéficieraient aux habitants de la terre en 2050 et au-delà. C’est cela la difficulté du changement climatique, qui n’est pas un gros requin bien visible et auquel on peut s’attaquer de suite. Son côté diffus, car il résulte de tous les aspects(énergivores) de notre vie, et l’absence de lien direct d’ “action-réaction”, incite à l’inertie -à commencer par celle des milieux politiques- depuis des années.
De l’économie
Le lien entre les problèmes climatiques, et notre économie sont connus : le lien entre l’économie actuelle et la consommation d’énergie, en particulier d’hydrocarbures, est clairement démontré depuis des années. Le modèle de croissance continue fait clairement partie du problème… Elle s’arrêtera de toute manière avec la diminution des énergies fossiles encore disponibles (et, non, on ne parviendra pas à tout remplacer par de l’énergie verte, n’en déplaise aux technocrates convaincus, car celle-ci se heurtera à un problème de ressources, notamment métalliques). Mais si on attend d’épuiser toutes ces ressources (dans 80 ans pour le pétrole, 200 pour le charbon), on aura rendu une grande partie de la planète inhabitable pour l’humain avec une augmentation de la température moyenne de 6° ou plus (-5° lors de la dernière période de glaciation, c’était la toundra sibérienne jusqu’à Berlin; je vous laisse imaginer ce que donne +6°).
Alors ? L’économie est clairement l’enjeu majeur. Mais la régression généralisée n’est pas souhaitable (pour les humains, le reste de la nature ne s’en porterait pas plus mal) car chacun·e d’entre nous a besoin d’un emploi pour vivre. L’attention doit se porter, me semble-t-il, sur le modèle économique. Il s’agit certes de faire moins, mais surtout autrement: ancrer des métiers qui font sens, qui apportent de la valeur “réelle” aux gens et à la société, et qui en même temps permettent à chaque travailleur·euse de s’épanouir. Le changement de paradigme doit surtout être guidé par un (ou des) indicateur différent car tant que notre mesure de ce que nous considérons être important n’a pas changé, nous continuerons à ne pas viser à l’essentiel.
Un futur désirable
Ce faisant, la différence majeure avec la crise actuelle est celle de la vision, de la projection dans notre futur. La crise du coronavirus se positionne clairement dans la préservation des acquis, dans un mouvement pour revenir le plus vite possible à la “normale”. En fait, il n’y a pas de vision, pas de changement qui est porté. C’est une bataille pour le statu quo.
C’est là que les défis de demain sont radicalement différents… et difficiles: car ils nécessitent de penser, réfléchir, vouloir… autre chose. Quelques chose que nous ne connaissons pas, ou du moins pas entièrement. Quelque chose qui implique un changement et qui donc fait peur. C’est de par cet aspect que les débats climatiques s’enlisent dans une guéguerre entre progressistes “de gauche” et conservateurs “de droite”: le souhait de changer vers quelque chose de prétendument meilleur (mais pas forcément pour nous, pour les autres ailleurs ou plus tard) versus la préservation des acquis dont nous bénéficions aujourd’hui et que l’on craint de perdre.
Et je rejoins Matthieu Peltier que je citais en début de texte: l’attitude morale et moralisante de la gauche ne suffit pas, ne fonctionne pas. Car elle positionne le problème sur le terrain exclusif des idées, voire de l’idéologie. Car elle tente d’imposer un impératif moral futur sur un ressenti direct, palpable là-maintenant. Car elle déconnecte ceux-mêmes qui l’édicte de leurs propres pratiques: trop de personnes soucieuses de l’environnement ou du changement climatique ne s’appliquent pas à elles-même ce qu’elles prônent. Nous sommes tou·tes ainsi truffées de limites, d’incohérences ou de résistances à certains changements qui nous pèsent plus.
Alors, ne serait-il pas plus judicieux de promouvoir le futur que nous souhaitons en le rendant désirable ? En montrant qu’on peut très bien vivre déjà ainsi et avoir une vie heureuse ? En remplaçant la voiture par le vélo, en passant de super vacances près de chez soi. En savourant de bons petits plats cuisinés avec des ingrédients locaux. En achetant ces ingrédients en vrac, sans (sur)emballage. En faisant sécher son linge à l’air et en redécouvrant le plaisir de se laver à l’évier une fois sur deux. Et en essayant d’adopter un nouveau geste chaque trimestre, sans perdre les précédents…
Tous ces éco-gestes ne sont pas des gestes “moraux”, mais les pièces d’un puzzle qui en se construisant définit notre futur… désirable puisque nous le vivrons déjà !
Sur ces quelques réflexions, je m’en vais définitivement lire (enfin) en entier Ecotopia, récit utopiste écrit en… 1975 ! Car se donner le temps de faire des choses dont on a envie fait aussi partie du puzzle.
Article migré début 2023 sur le nouveau site, sans les commentaires